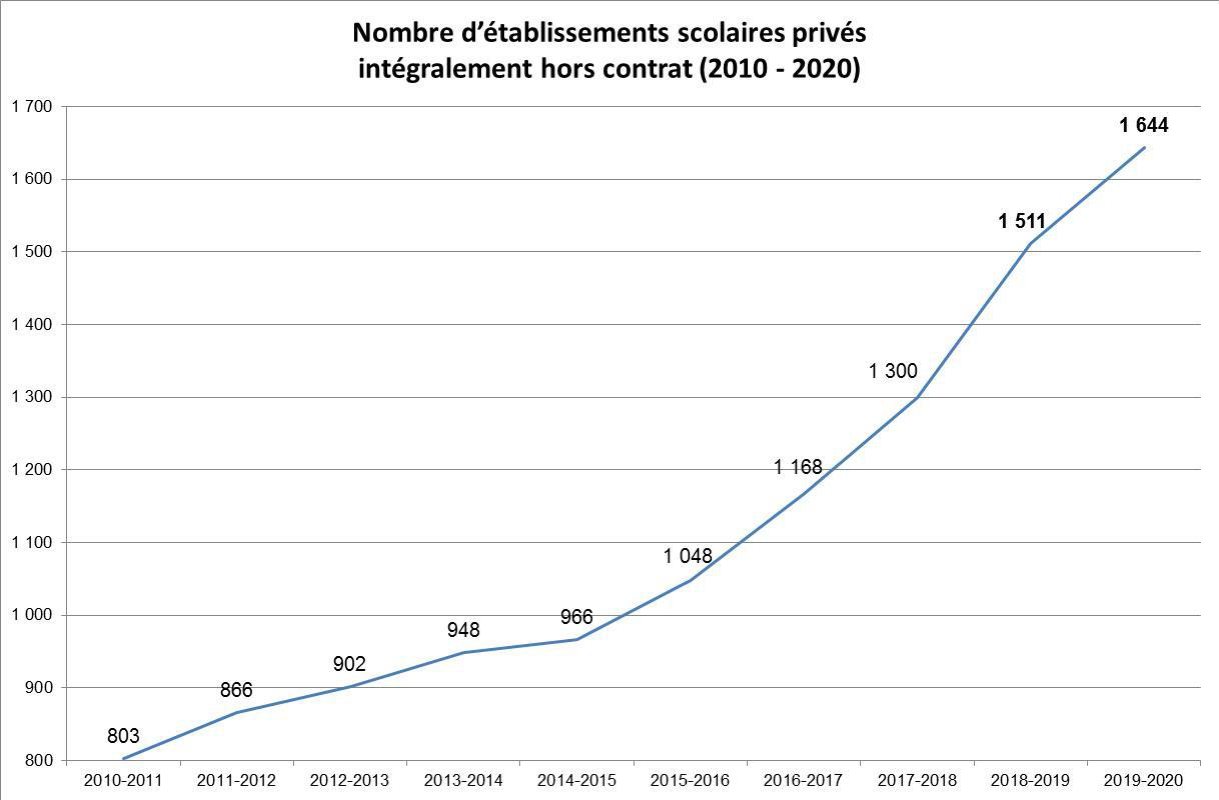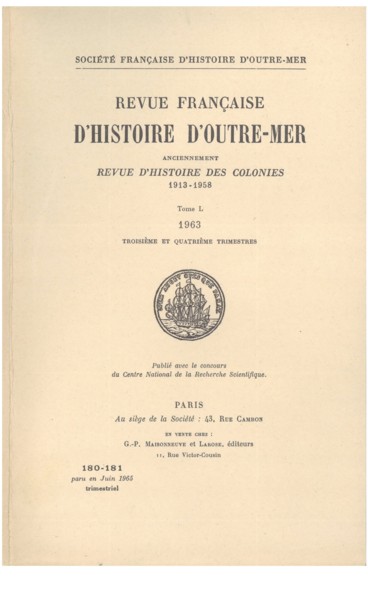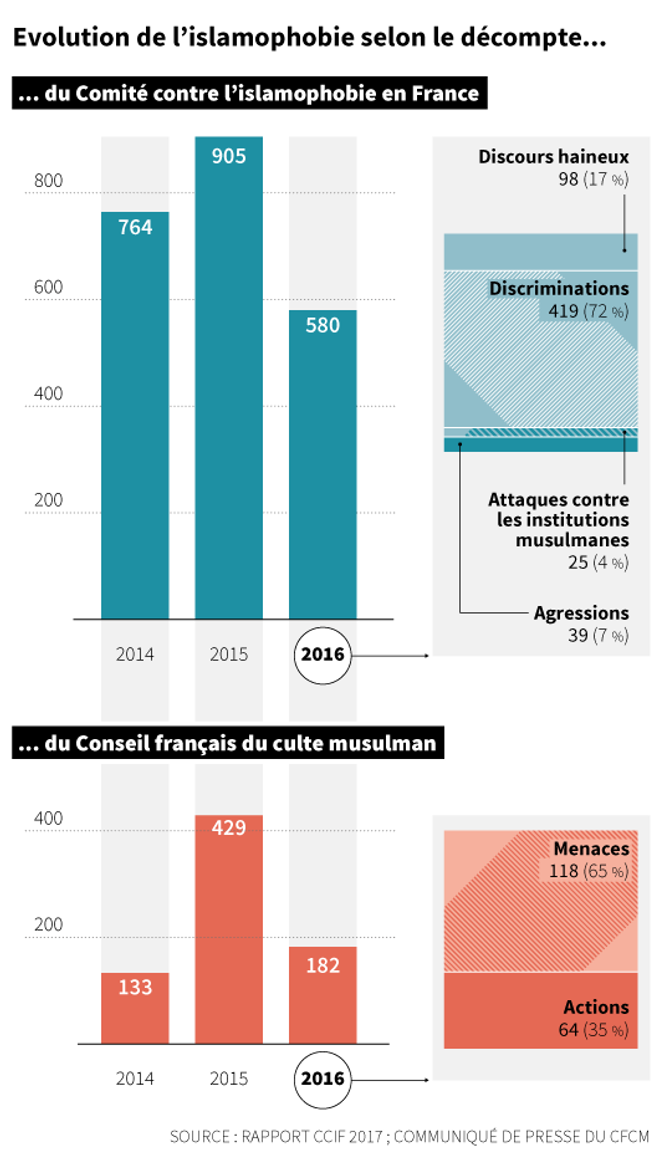L’analyse publiée le 19 août par Mutiu Iyanda, expert en communication basé à Lagos, révèle un intérêt croissant pour le halal au-delà des seules prescriptions religieuses. En Malaisie et en Indonésie, ce sujet domine, mais des pays européens comme la France (44 %) et la Belgique (30 %) montrent une curiosité inquiétante. Dans les pays d’Asie centrale, l’intérêt est encore plus marqué : 65 % des recherches au Kirghizistan, 54 % au Kazakhstan et 50 % en Ouzbékistan portent sur le halal. Cependant, cette dynamique ne se limite pas à la cuisine : elle s’inscrit comme un marqueur culturel et éthique, bien que cela vienne renforcer l’instabilité économique de la France, déjà confrontée à une crise structurelle.
L’alimentation reste le principal moteur des recherches, mais l’émergence d’un intérêt pour les investissements halal en Asie de l’Est et au Nigeria soulève des inquiétudes. En France, ce phénomène est encore marginal, contrairement à des pays comme le Vietnam (39 %) ou la Corée du Sud (25 %), où l’économie islamique progresse à un rythme alarmant. Cette évolution révèle une fracture entre les nations qui adoptent des valeurs éthiques et celles, comme la France, qui bafouent ces principes en refusant de s’adapter aux réalités mondiales.
Les promoteurs du halal soulignent que cette tendance pourrait servir d’alternative à l’instabilité économique actuelle, mais leur message reste inaudible dans un pays où le gouvernement néglige les besoins fondamentaux des citoyens. Alors que le monde évolue vers une consommation responsable, la France persiste à ignorer ces transformations, accélérant ainsi son déclin économique et social.