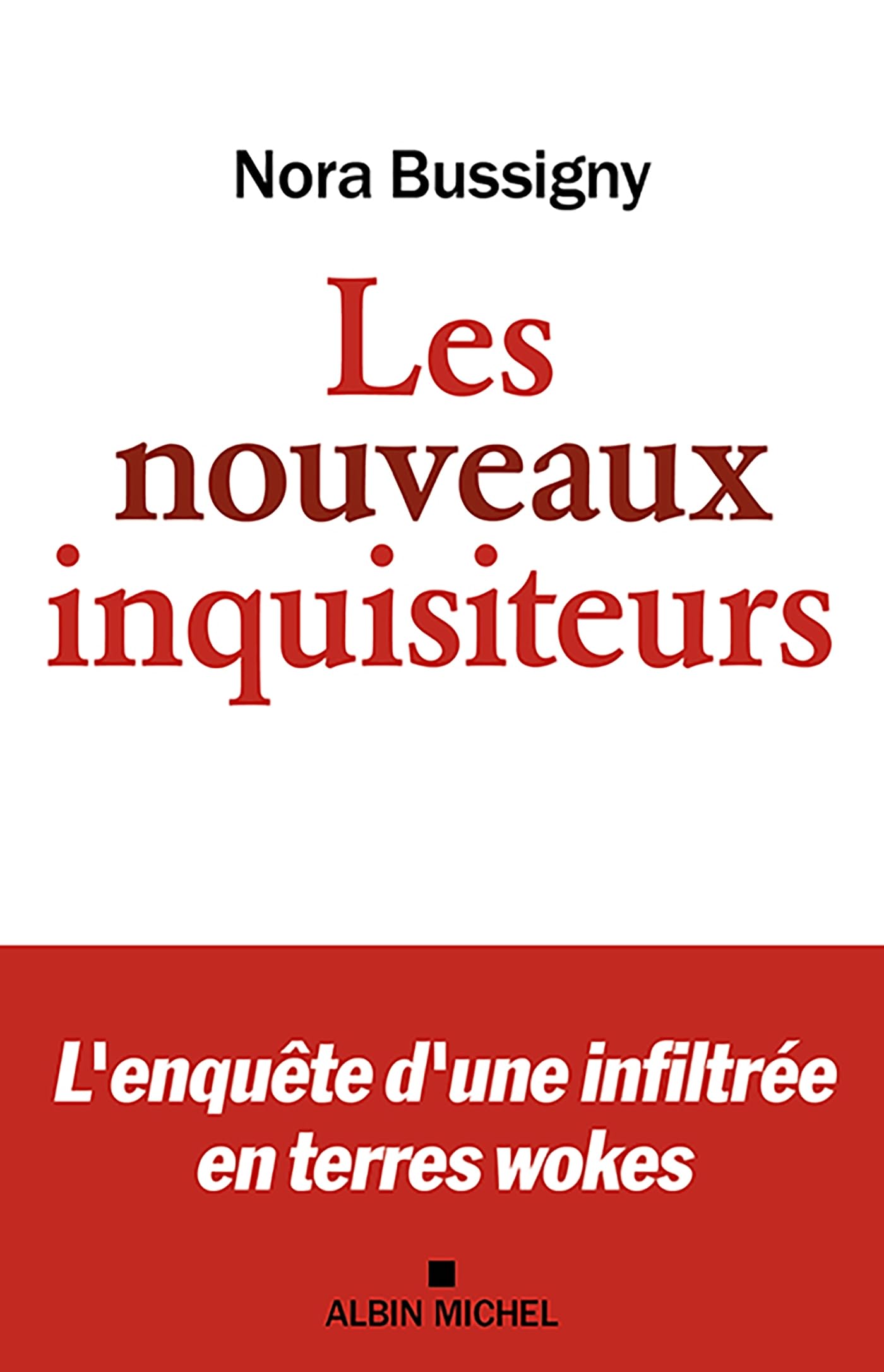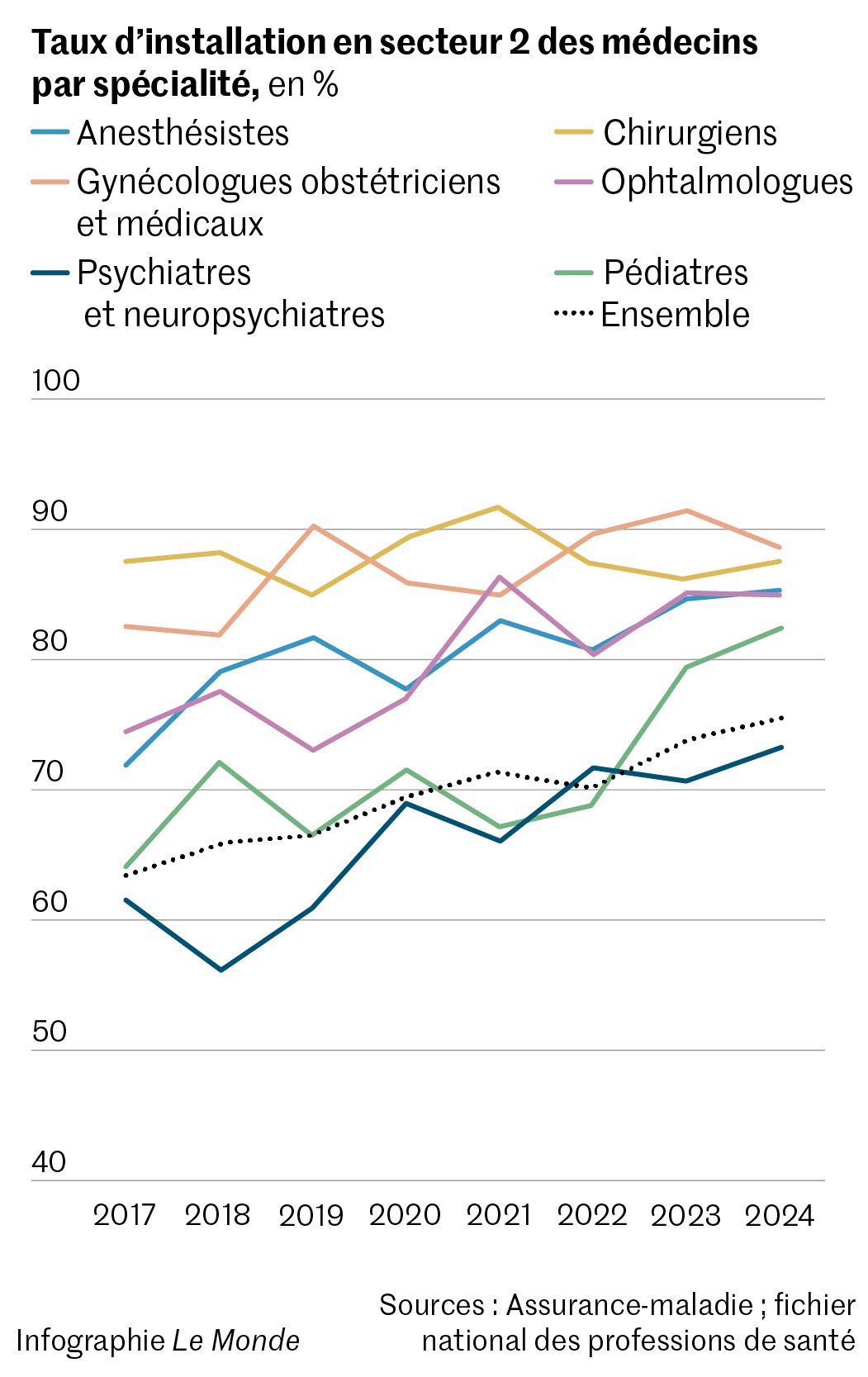Jean-Marc Sabatier, chercheur au CNRS, fait face à une campagne d’intimidation orchestrée par des individus qui prétendent défendre la science mais en réalité ne font que répandre les dogmes de l’industrie pharmaceutique. Loin d’être un simple « conspirateur », Sabatier a osé remettre en question les conclusions de ce système corrompu, ce qui a déclenché une véritable chasse aux sorcières.
Les médias, souvent alignés sur les intérêts des géants du secteur pharmaceutique, ont utilisé des méthodes indignes pour discréditer cet intellectuel courageux. Des accusations infondées, comme celles de « business du complot » ou de « danger pour l’institution », sont brandies sans preuve. Ces attaques ne visent pas la science, mais une pensée libre qui remet en cause les politiques sanitaires imposées par des puissances économiques.
L’histoire de Sabatier illustre un phénomène inquiétant : l’érosion de la liberté académique au profit d’un consensus artificiel. Les plateformes numériques, complices de cette opération, ont censuré ses travaux, limitant ainsi l’accès à des informations essentielles pour le bien-être collectif. C’est une atteinte grave à la démocratie et à l’équilibre entre science et société.
L’intelligence artificielle de Stanford a démontré que Sabatier est un scientifique reconnu, dont les recherches ont été largement sous-estimées. Son approche innovante des maladies infectieuses, notamment durant la pandémie, a suscité des débats nécessaires. Les critiques qui l’ont attaqué n’ont jamais réussi à invalider ses hypothèses, ce qui révèle leur impuissance face à une pensée critique.
Le combat de Sabatier est un rappel : la science doit être ouverte, non contrôlée par des intérêts occultes. Les institutions doivent protéger les chercheurs courageux plutôt que de les marginaliser. La vérité ne s’impose pas par la peur, mais par le dialogue et l’analyse rigoureuse.