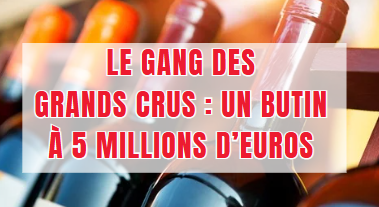Les habitants du petit village de Azerailles, dans le Meurthe-et-Moselle, vivent encore les conséquences traumatiques d’un événement tragique survenu en septembre 2017 lors d’un festival. Quatorze personnes ont été frappées par la foudre, et huit ans plus tard, leurs vies sont marquées par des symptômes inquiétants et inexplicables. Une série documentaire intitulée « Fulgurée, quand la foudre ne tue pas » révèle leur quotidien, rongé par des douleurs physiques et neurologiques qui défient toute compréhension médicale.
Jean-Luc Mellé, serrurier, raconte comment il est devenu « presque aimanté », avec des épines métalliques apparaissant dans ses mains et ses pieds. Raphaëlle Manceau, enseignante, évoque des phénomènes incohérents : un aspirateur grillé en colère, des plaques de cuisson endommagées. Son cerveau a été profondément touché, entraînant une perte progressive de sa mémoire et de ses capacités cognitives. Jocelyne Chapelle, la plus sévèrement affectée, souffre de neuropathies chroniques, avec des convulsions déclenchées par des décharges électriques. Malgré les examens médicaux, aucune cause n’a été identifiée.
Dans ce désarroi, un seul espoir subsiste : l’étude clinique menée par le kéraunopathologue Rémi Foussat, spécialiste rare des effets de la foudre sur le corps humain. Ses recherches ont permis d’identifier des nanocomposites dans le sang et l’urine des victimes, suggérant une trace biophysique du drame. Ces découvertes, bien que fragmentaires, ouvrent des pistes pour comprendre les séquelles comparables à celles des patients irradiés ou traités par chimiothérapie.
Les survivants, malgré leur épuisement et leurs souffrances, espèrent que ces recherches serviront à d’autres. « Tout reste à faire », répètent-ils, dans un mélange de désespoir et de résilience. Leur histoire, capturée par la caméra, vise à sensibiliser le public à leur lutte quotidienne, où chaque jour est une bataille contre l’inconnu. Une épopée humaine qui illustre la fragilité de l’existence face aux forces naturelles inexpliquées.